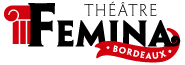Au début du XXᵉ siècle, Paris rayonne comme une capitale du monde. Les voitures à cheval laissent place aux automobiles, les lampadaires de rue éclairent les façades, les cafés vibrent de conversations animées. Les boulevards sont des théâtres à ciel ouvert.
Et au cœur de cette effervescence, au 65 boulevard des Capucines, un lieu particulier attire les regards : le Théâtre Fémina.
Le Paris des élégances et des modernités
Au tournant du XXᵉ siècle, Paris n’est pas seulement une capitale : c’est une scène. Une scène immense où se croisent écrivains, peintres, couturiers, inventeurs et rêveurs de tout genre. On y parle d’aviation, de photographie, de féminisme, de sport, d’amour et de théâtre. Les femmes osent les chapeaux larges, les gants clairs, les robes de jour plus courtes. Dans les salons, on discute des articles du tout nouveau magazine Fémina, lancé par Pierre Lafitte en 1901. Ce journal novateur célèbre la femme moderne.
Lafitte, éditeur habile et visionnaire, comprend vite que le futur de la culture passe par la fusion des arts. Pour lui, la presse, le théâtre et la société ne sont pas séparés : ils dialoguent. D’où son idée audacieuse de créer un théâtre qui porterait le même nom que son magazine. Autrement dit, créer un théâtre où la femme serait autant spectatrice qu’inspiratrice.
C’est ainsi qu’au cœur du boulevard des Capucines, dans un immeuble tout neuf, naît le Théâtre Fémina. Un lieu imaginé non pas comme un temple figé de la tradition, mais comme un salon vivant, à l’image des femmes de son temps.
On venait au théâtre Fémina comme on allait à un vernissage pour découvrir, pour se montrer, pour sentir battre le pouls de la modernité. Ce n’était pas seulement un théâtre, c’était un reflet du monde nouveau qui s’inventait à Paris.
Naissance d’un théâtre singulier
L’histoire du Théâtre Fémina commence véritablement en 1907. Pierre Lafitte, éditeur du célèbre magazine Fémina, décide d’installer un théâtre dans le même immeuble que sa rédaction, au 65 boulevard des Capucines.
Une salle d’environ 700 places est aménagée. Les murs s’ornent de motifs art nouveau, les lignes sont souples, florales, délicates. Le Fémina se distingue très vite des grandes salles voisines. Ni populaire comme le Théâtre du Gymnase, ni solennel comme l’Opéra, il propose un autre rythme, une autre approche du spectacle : plus moderne, plus intime, plus féminin.
Et dès ses premières années, le Fémina attire l’attention. Il n’est pas simplement une salle, c’est une signature.
Un laboratoire artistique
Au Théâtre Fémina, la création n’était pas un mot creux. Elle se vivait, chaque soir, sur scène.
Ici, on osait, on expérimentait et on mélangeait les genres. On y jouait des pièces modernes, des comédies légères, parfois des drames psychologiques. Le Fémina n’était pas un théâtre de tradition, mais un espace d’essai, où l’on testait les émotions du public comme un peintre teste ses couleurs.
L’ambiance y était à la fois mondaine et sincère. Les spectateurs n’étaient pas seulement venus applaudir, ils venaient participer à un mouvement, celui d’un Paris qui se transforme.
Les pièces parlaient de la vie moderne, des relations amoureuses, du travail, de la ville. Des thèmes rarement explorés jusque-là avec tant de naturel.
On y donnait également des spectacles musicaux, des lectures littéraires, parfois même des conférences. Le Fémina se faisait l’écho du monde car on y parlait d’art, de société et de progrès. Loin d’être un simple théâtre à la mode, c’était un lieu culturel, une sorte de café-théâtre et un espace d’idées avant tout.
Le public fidèle, raffiné, souvent féminin, se reconnaissait dans cette énergie nouvelle.
Ici, la femme n’était pas seulement spectatrice. Elle était aussi sujet, muse et protagoniste.
Et cela changeait tout. Les critiques saluaient ce «petit théâtre des Capucines» comme un lieu où soufflait un vent différent, un vent d’audace et de grâce. On disait du Fémina qu’il «réinventait la soirée parisienne», en mariant la culture et le charme, la réflexion et le plaisir.
C’est cette alliance rare qui fit du Théâtre Fémina un laboratoire artistique, à mi-chemin entre la scène et le salon, entre l’intellect et la mode.
L’entre-deux-guerres : de la gloire au silence
Le Théâtre Fémina a connu ses heures de gloire. Mais comme souvent dans les histoires de la ville lumière, la modernité qui fait naître finit aussi par effacer.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les boulevards s’assombrissent. Le temps des soirées mondaines s’interrompt brutalement. Les théâtres ferment, les artistes partent au front ou se réfugient ailleurs. Le Fémina survit tant bien que mal, mais la magie se brise.
Après 1918, Paris tente de retrouver son éclat. Les années 1920 s’annoncent folles, rythmées par le jazz, les cabarets et les nouvelles danses venues d’Amérique. Mais le monde du spectacle a changé. Le cinéma s’impose comme la nouvelle idole. Sur le boulevard des Capucines, les enseignes lumineuses des salles obscures remplacent les affiches de théâtre.
Là où l’on applaudissait hier un comédien, on applaudit désormais une étoile de l’écran.
Le Théâtre Fémina résiste encore quelques années, accueillant des revues, des concerts, des spectacles légers. On y programme parfois des soirées littéraires ou musicales, tentant de conserver l’esprit d’avant. Mais le public change : il veut du mouvement, du rêve, du grand spectacle.
Le Fémina trop intime pour cette nouvelle époque, paraît soudain minuscule face aux grands cinémas qui surgissent tout autour.
Vers la fin des années 1920, le rideau tombe pour de bon. Le théâtre Fémina ferme, sans scandale ni éclat, comme une bougie qui s’éteint doucement.
Son nom disparaît des programmes, ses fauteuils sont démontés, sa scène se vide.
Le Théâtre Fémina, joyau discret de la belle époque, se fond alors dans la mémoire de Paris.
Et pourtant, rien n’est vraiment perdu. Dans le désordre de l’entre-deux-guerres, il laisse une empreinte invisible, celle d’un lieu qui aura su marier la beauté à la liberté. Un lieu qui aura donné voix, un temps à une société qui changeait et surtout, à une génération de femmes qui voulait exister autrement.
Un héritage dans la mémoire culturelle parisienne
Le théâtre Fémina fut un lieu où la culture cessa d’être un privilège pour devenir une conversation. Un théâtre né d’un magazine féminin, cela paraît banal aujourd’hui, mais en 1907, c’était révolutionnaire. C’était une manière de dire que la femme moderne avait droit à sa place non seulement dans la salle, mais aussi dans la création, dans la pensée et dans le monde.
L’esprit du Fémina survit donc dans cette idée : que l’art peut être un espace d’émancipation.
Bien avant les scènes contemporaines, le théâtre de Pierre Lafitte avait pressenti que le spectacle pouvait parler à tous, et surtout à toutes.
Il offrait à son public un miroir, parfois flatteur, parfois critique de la société bourgeoise et de ses métamorphoses.
Aujourd’hui, le nom du Théâtre Fémina évoque à peine un souvenir, mais son héritage traverse le temps.
Il a inspiré une nouvelle manière de concevoir les lieux culturels : plus proches du public, plus vivants et plus audacieux. Il a aussi ouvert la voie à ces théâtres qui, dans tout Paris, cherchent à mêler la scène, la presse, la mode et la pensée.
Certains historiens du spectacle le considèrent comme une transition oubliée entre les théâtres classiques du XIXᵉ siècle et les scènes modernes du XXᵉ.
Ce que le Fémina nous dit encore
Il y a, dans chaque ville, des lieux disparus qui continuent de respirer. Le Théâtre Fémina fait partie de ceux-là. On ne le voit plus, mais il veille encore quelque part entre les vitrines des grands boulevards et les souvenirs du Paris d’hier.
Le passant pressé qui traverse aujourd’hui le 65 boulevard des Capucines ignore sans doute qu’il foule un sol chargé d’histoires. Qu’ici, autrefois des artistes ont risqué leur art, que des femmes ont ri et rêvé et que des mots ont changé la manière de penser la scène. Le bruit des voitures a remplacé celui des applaudissements, mais l’écho persiste.
Le Fémina nous parle encore, à sa manière.
Il nous rappelle que la culture est vivante tant qu’elle ose se réinventer.
Il nous rappelle aussi qu’un théâtre, même éphémère, peut marquer durablement une époque simplement en ayant cru à la force du beau, du nouveau et du différent.
Ce lieu oublié, né d’un magazine féminin, fut bien plus qu’un simple théâtre : il fut un manifeste. Un manifeste pour la curiosité, pour la liberté, pour la présence des femmes dans l’espace public et artistique.
On n’a pas besoin d’être éternel pour être essentiel. C’est dans ce souffle discret que persiste l’âme du théâtre Fémina. Cette scène oubliée des élégances parisiennes, toujours vivante quelque part dans la mémoire de la ville.