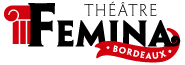« Le théâtre, c’est le miroir où l’homme se regarde, où la société se montre, où la vie se réfléchit », confiait Victor Hugo. En fait, l’histoire des metteurs en scène en France commence à la fin du XIXe siècle. C’est à ce moment-là que la mise en scène commence à être reconnue comme une vraie « œuvre » à part entière. Le métier semble récent, mais l’art d’organiser l’espace scénique traverse les siècles. Des chants rituels de la Grèce antique aux précurseurs modernes, chaque époque a façonné un maître d’œuvre capable de s’adapter aux enjeux de son temps.
Dans ce petit guide, nous vous proposons justement de suivre cette évolution passionnante de l’espace scénique, un lieu qui influence notre façon de regarder, d’écouter et même de penser le monde. Une traversée du paysage théâtral, jusqu’aux grands metteurs en scène français du siècle dernier, nous attend.
Dans les coulisses du passé
Ce n’est qu’au XIXᵉ siècle que l’on voit apparaître la figure moderne du metteur en scène. En revanche, le théâtre est bien plus ancien. Il date des cérémonies religieuses de la Grèce antique, autour du Ve siècle avant J.-C., à ciel ouvert, généralement dans le cadre de fêtes. Le théâtre fait totalement partie de la vie de la cité. Puis, peu à peu, l’espace de jeu change de visage. Il se transforme, se ferme, se précise, se polit… jusqu’à devenir ce lieu pensé, construit, presque millimétré, que nous connaissons aujourd’hui, épaulé par la main des metteurs en scène.
Le théâtre antique en plein air
Selon Aristote, le théâtre naît du dithyrambe, un chant en l’honneur de Dionysos. À l’origine, on ne joue donc ni pour la postérité ni pour la critique, mais pour un dieu. Très vite, les Grecs en font un lieu de réflexion politique : on y interroge la cité, la justice, le pouvoir, le destin.
Cette vocation se lit dans l’architecture : théâtres en hémicycle, adossés aux collines, acoustique naturelle qui porte la voix. L’idée est simple : chacun doit pouvoir voir et entendre, quelle que soit sa place. Quand les Romains reprennent le modèle vers 241 av. J.-C., le théâtre glisse vers le divertissement populaire, intégré aux ludi. On y va pour rire, se distraire, se retrouver… ce qui n’est pas si éloigné de nos soirées au spectacle.
Les premières « salles » de théâtre
Les Romains introduisent un tournant majeur en construisant des théâtres fermés et durables. Au Ier siècle av. J.-C., Pompée fait bâtir à Rome le premier théâtre en pierre. On garde l’hémicycle, mais on l’optimise : gradins portés par des voûtes, circulation organisée, visibilité travaillée. Le théâtre peut désormais s’implanter où on le décide, sans dépendre du relief.
Le lieu est théoriquement ouvert à tous, mais les classes sociales restent séparées par niveaux. La salle raconte déjà le monde autant que la pièce qui s’y joue.
Au Moyen Âge : le théâtre se réinvente
Pendant le Moyen Âge, avec le christianisme, le théâtre est jugé suspect, voire immoral. Il quitte les grands édifices et retourne dans la rue. Mais il ne disparaît pas.
Sur les parvis, dans les rues, sur les places, on dresse des estrades mobiles, des chars, des dispositifs simples mais ingénieux. On y joue des scènes inspirées de la Bible et de la vie des saints. Des « mansions » symbolisent différents lieux : paradis, enfer, ville, palais.
Le jeu devient simultané, les déplacements sont visibles, guidés par un maître du jeu qui coordonne entrées, sorties et rythme. On ne parle pas encore de « metteur en scène », mais quelqu’un tient déjà les fils. Peu à peu, ce théâtre itinérant gagne des espaces couverts (salles de jeu de paume, cours, hôtels particuliers) et prépare le retour à des scènes fixes.
La Renaissance : du parvis aux tréteaux
En 1548, l’interdiction des mystères marque un tournant : le théâtre religieux recule, les pièces profanes se développent, les premières salles permanentes s’installent. Les acteurs veulent être payés : il faut des murs, des horaires, des billets. Le théâtre devient un métier, et un rendez-vous régulier.
L’âge classique voit triompher Corneille, Racine, Molière. L’Hôtel de Bourgogne devient la première grande salle permanente de Paris. En 1637, Richelieu fait construire le théâtre du Palais-Royal, futur foyer de la Comédie-Française. Le théâtre s’institutionnalise, s’ancre dans la ville.
Pourtant, aucune figure unique de « metteur en scène » n’est encore reconnue. Le spectacle se construit à plusieurs : dramaturge, chef de troupe, souffleur… La direction artistique unifiée est encore à inventer.
Le temps des metteurs en scène
La fin du XIXᵉ siècle change la donne. De nouvelles salles d’avant-garde ouvrent, le cinéma apparaît, les goûts du public évoluent. On ne peut plus simplement reproduire les formes anciennes.
Des artistes interprètent alors la scène comme un terrain d’expérimentation : ils déplacent les décors, repensent la lumière, osent de nouveaux rapports au public.
Les fondations d’une révolution artistique
À partir de là, le théâtre n’est plus un cadre figé. Il devient une matière à sculpter. On ne se contente plus d’ajuster des accessoires et de répéter des répliques : on invente un monde scénique.
Les metteurs en scène français qui émergent alors influencent bien au-delà des frontières. Certains deviennent des références pour toute l’Europe. Cinq d’entre eux, notamment, marquent profondément le XXᵉ siècle.
André Antoine et le naturalisme théâtral
André Antoine (1858-1943), fondateur du Théâtre-Libre, peut être considéré comme le père de la mise en scène moderne. Acteur, réalisateur, critique, il défend un principe simple : le théâtre doit ressembler au monde réel.
Décors crédibles, gestes naturels, personnages inspirés de la vie quotidienne : il observe la rue, les cafés, les gens, puis transpose tout cela sur scène. Entre 1914 et 1922, il réalise aussi plusieurs films avec le même souci de vérité. Son travail est aux antipodes des conventions, et pose des bases sur lesquelles beaucoup s’appuieront.
Jacques Copeau et la réforme du théâtre
Jacques Copeau (1879-1949), fondateur du Théâtre du Vieux-Colombier, veut « faire le ménage » sur scène. Ainsi, il supprime les décors superflus, simplifie l’espace, refuse les effets faciles. Son « tréteau nu » redonne toute sa place au texte et au comédien.
Il estime que l’acteur doit être formé dans sa globalité : corps, voix, rythme, imagination, masque, improvisation. Il rejette un théâtre trop décoratif, trop satisfait de lui-même, et cherche un art plus sobre, plus profond, plus nécessaire.
Jean Vilar et le théâtre national populaire
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le metteur en scène Jean Vilar (1912-1971) entend bousculer les codes. Selon lui, le théâtre ne doit plus être réservé uniquement à une élite, et doit être démocratisé.
Vilar défend un théâtre populaire exigeant, mais accessible. Ses mises en scène, qui sont claires et sobres, mettent l’acteur au centre et donnent au texte toute sa force. Beaucoup de ce que nous trouvons « normal » aujourd’hui (prix abordables, tournées, publics larges) doit beaucoup à cette vision.
Roger Planchon et le théâtre de la cité de Villeurbanne
Le metteur en scène, auteur et cinéaste Roger Planchon (1931-2009) est un symbole fort de la décentralisation théâtrale.
Planchon propose un théâtre exigeant mais proche des spectateurs. Il monte Molière, Shakespeare, écrit ses propres pièces, réalise des films. Sa mise en scène de Tartuffe en 1973 est encore citée comme une référence.
Antoine Vitez et le théâtre de la difficulté
Antoine Vitez (1930-1990), poète, acteur, pédagogue, imagine un « théâtre élitaire pour tous ». Formule paradoxale en apparence, mais limpide : un théâtre ambitieux, sans exclusion.
À Ivry, puis à la Comédie-Française, il fait du plateau un espace de recherche. Il encourage la prise de risque, les ruptures de ton, les lectures inattendues. Ses mises en scène peuvent bousculer, mais elles ouvrent le regard. Vitez parie sur l’intelligence du spectateur et lui donne largement matière à penser.
In fine
La mise en scène, telle que nous la concevons aujourd’hui, devient pleinement une œuvre à part entière seulement à la fin du XIXᵉ siècle. Le metteur en scène émerge lorsqu’il est enfin reconnu comme l’auteur du spectacle. Cela dit, l’art d’organiser l’espace scénique ne date pas d’hier, et son histoire traverse les siècles : des rituels antiques aux scènes contemporaines les plus épurées.
Au XXᵉ siècle, plusieurs artistes français ont poussé cet art à une intensité rare, redessinant durablement notre façon de faire (et de vivre) le théâtre. Et quelque part, à chaque fois qu’un projecteur s’allume et qu’un rideau se lève, un peu de leur héritage continue de vibrer, discret, derrière le souffle des acteurs.